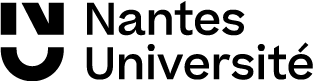- Recherche
- Sciences et Société
Avez-vous bien compris cette carte ?
-
Le 26 novembre 2025false false
Dans leur étude, Davret & Trouillet (2025) montrent que les cartes utilisées dans la planification spatiale maritime ne sont pas de simples outils, loin d’être neutres, ce sont des leviers de pouvoir. Elles façonnent notre manière de voir la mer et influencent les décisions sur l’usage des espaces marins. L’étude révèle que les acteurs ne sont pas de simples « utilisateurs » passifs des cartes : ils en font une lecture critique qui met en lumière les choix méthodologiques sous-jacents à leur fabrication.
Dans leur étude, Davret & Trouillet (2025) montrent que les cartes utilisées dans la planification spatiale maritime ne sont pas de simples outils, loin d’être neutres, ce sont des leviers de pouvoir. Elles façonnent notre manière de voir la mer et influencent les décisions sur l’usage des espaces marins.
Pour comprendre comment les parties prenantes perçoivent ces cartes, les auteurs ont organisé quatre ateliers de travail réunissant 30 acteurs au total : professionnels de la pêche, associations, représentants de l’État, scientifiques, professionnels de la plaisance. Les ateliers ont permis d’examiner comment les participants comprennent une série de cartes sur la pêche et la plaisance créées par la Chaire Maritime[1] ainsi que des cartes produites par l’État et présentes dans le Document Stratégique de Façade. Les auteurs ont ensuite analysé les échanges via un logiciel d’analyse de texte.
L’étude révèle que les acteurs ne sont pas de simples « utilisateurs » passifs des cartes : ils en font une lecture critique qui met en lumière les choix méthodologiques sous-jacents à leur fabrication.
Les discussions montrent que plusieurs éléments polarisent fortement les échanges. Pour la plaisance, les débats portent surtout sur la difficulté à définir l’activité à cause du manque de données fiables. Pour la pêche, les critiques se concentrent sur le questionnement des traitements techniques et des choix de représentations : maillages, indicateurs, catégories de navires, temporalité, etc. Concernant les cartes produites par l’État, les acteurs discutent prioritairement des objectifs du document, de la pertinence du cadrage politique, et de la lisibilité et l’accessibilité des représentations.
L’analyse des échanges met aussi en évidence des différences nettes entre catégories d’acteurs. Parmi les participants, les acteurs professionnels soulèvent des limites d’interprétation, de compréhension et de difficultés pratiques face aux cartes. Les acteurs associatifs insistent sur l’importance de la transmission d’informations et la nécessité de rendre les cartes compréhensibles. Les représentants de l’État se focalisent sur la vision stratégique des cartes, leur rôle dans la mise en place de la planification et les objectifs qu’elles traduisent. Enfin, les scientifiques se concentrent davantage sur les limites, la validité des indicateurs, les problèmes méthodologiques.


Image 1 : deux ateliers de travail
Au-delà de l’analyse des échanges, les ateliers montrent également que les cartes jouent un rôle dans la structuration des rapports de pouvoir. Certains jeux d’acteurs apparaissent clairement : les décisions de traitement des données sont parfois prises en amont, par les producteurs de cartes ou par des services techniques, sans que cela soit discuté dans les espaces décisionnels ou de façon collective. Inversement, d’autres participants ont tendance à se rallier aux positions des acteurs dominants, ce qui produit un effet de consensus par argument d’autorité dans les débats.
Enfin, un point essentiel ressort : la plupart des participants sont conscients que les cartes ne reflètent pas simplement la réalité, mais la construisent. Elles orientent les discussions, légitiment certaines données plutôt que d’autres et influencent la manière dont l’espace marin est pensé et géré.
Les auteurs soulignent donc l’importance d’ouvrir la « boîte noire » de la carte dans les processus de planification marine. Cela implique :
- davantage de transparence sur la sélection, le traitement et la représentation des données ;
- une meilleure prise en compte des savoirs locaux et de l’expérience de terrain ;
- des dispositifs réellement participatifs, où les cartes ne sont pas seulement présentées, mais coconstruites ;
- une vigilance accrue sur les enjeux techniques des outils géographiques.
En reconnaissant la capacité des acteurs à analyser et critiquer les cartes, la planification marine peut devenir plus démocratique et plus équitable. Cette étude rappelle ainsi que les cartes ne sont jamais de simples supports visuels : ce sont des instruments politiques, capables de façonner les décisions et de redessiner les équilibres entre activités maritimes.
--
Lien vers l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901125000991?via%3Dihub
Juliette Davret est docteure en géographie (Université de Nantes, 2023) et chercheuse postdoctorale à l’Université de Maynooth (Irlande).
Brice Trouillet est professeur des universités à Nantes Université (Laboratoire LETG - UMR 6554 CNRS), France.
[1] Pour voir le détail des cartes : Juliette DAVRET, « Déconstruire les cartes maritimes : révéler les choix cartographiques à travers la pêche et la plaisance », L’atlas Bleu, Revue cartographique des mers et des littoraux. Mis en ligne le 10 juillet 2024. URL : https://atlas-bleu.cnrs.fr/ DOI : 10.35109/atlasbleu-fr.10048